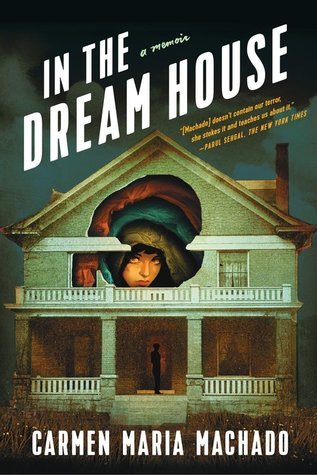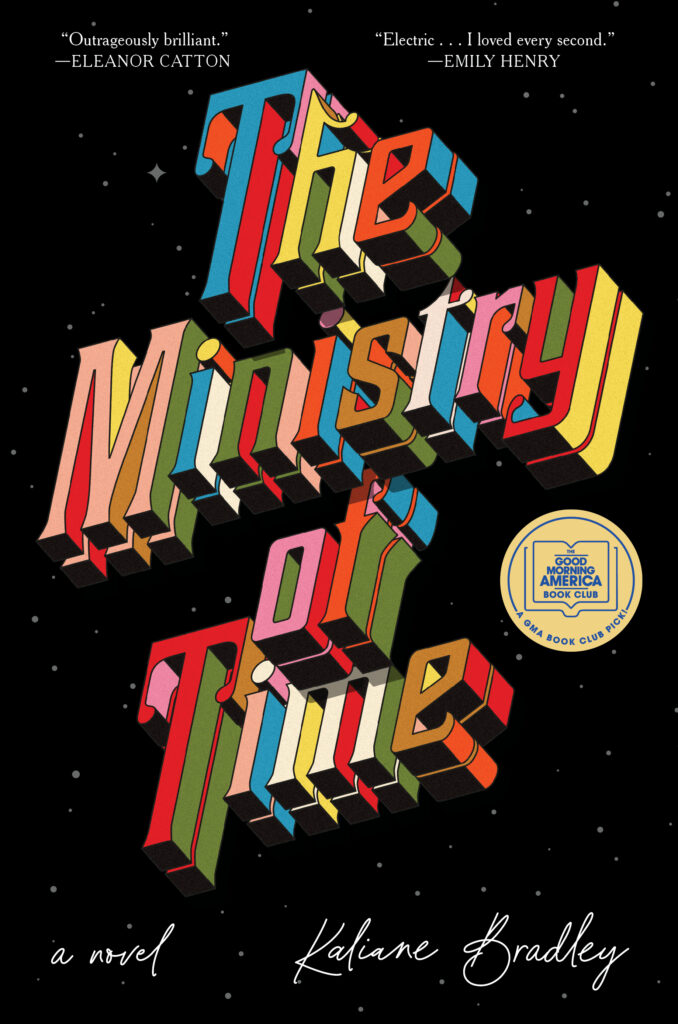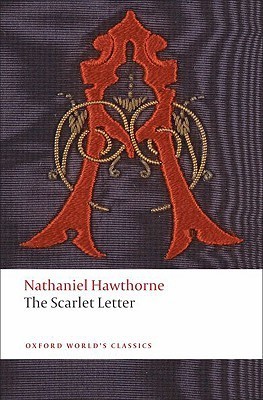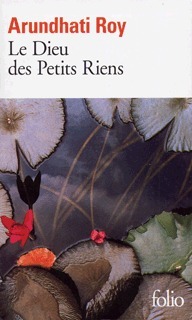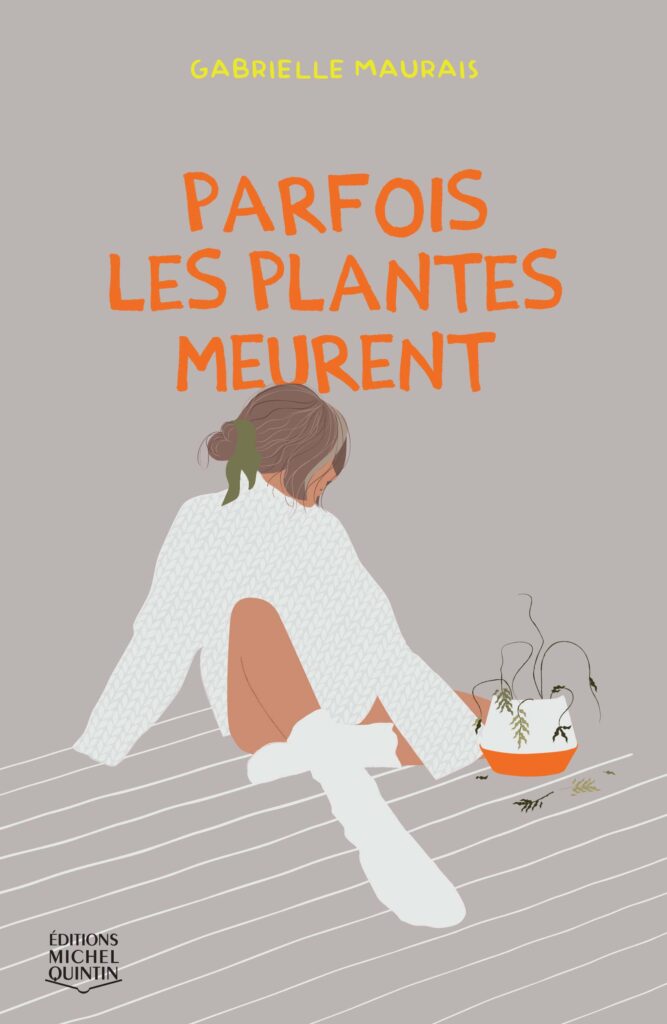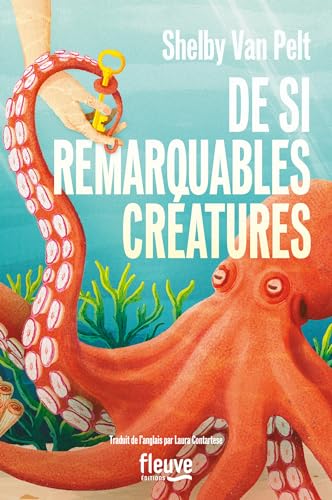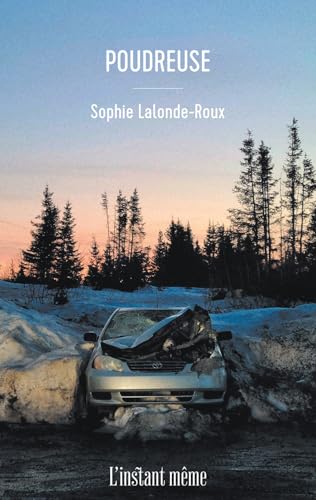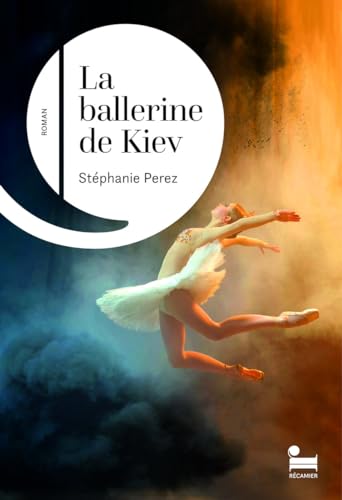
Disons-le d’emblée, l’autrice n’est pas ukrainienne. Si vous ne lisez que du own voice, ça risque vous déranger. Par contre, elle est journaliste et elle a déjà visité le pays en plus de faire des recherches. Vous voilà donc avertis!
De quoi ça parle
Sviltalna et Dmytro sont danseurs étoiles à l’opéra de Kiev. Ils vivent pour la musique, pour la danse, le mouvement et cultivent la perfection de leurs corps, leur outil de travail. Sauf que nous sommes en 2022 et que bientôt, les bombes vont pleuvoir et la guerre va éclater.
Mon avis
À voir la couverture, je croyais avoir affaire à un roman YA sur la danse. Je ne l’avais donc pas repéré d’emblée avant que Mallo me dise qu’il en valait le coup et que mon idée préconçue était totalement à côté de la plaque. Comme souvent, elle avait raison! Il faut dire qu’on a souvent des goûts communs, elle et moi.
Nous sommes donc avec un couple de danseurs. Ils sont célèbres, adulés dans leur domaine. Ils ne le savent pas, mais ils viennent de danser ensemble pour la dernière fois. Nous suivrons l’homme et la femme dans leurs choix respectifs et aussi dans leurs différents parcours. Si vous connaissez un peu l’histoire de Vladminir Shklyarov, vous comprendrez rapidement où je m’en vais. C’est d’ailleurs cette expérience qui a inspiré l’un des personnage. Ces personnages sont zéro équipés pour la guerre, pour les bombes et la peur, pour les abris sous-terrains. Qui l’est, direz-vous. Mais leur vie, c’était paillettes, pointes, corps qu’on maîtrise et qu’on dompte. Leur vie c’était l’art. Et quelle place a l’art dans toute cette horreur?
Nous avons donc un roman très touchant, émouvant au possible, où la souffrance et la douleur ne nous est pas éparganée. Ce n’est pas fleur bleue, aucun faux romantisme à propos de la guerre, mais nous aurons des personnages qui devront s’élever plus haut qu’eux-mêmes. Nous vivrons les premiers mois de cette guerre qui ne finit plus, ça parle d’amour, de solidarité mais surtout de résilience. Svitlana devra se dépasser pour jeter une certaine lumière, une certaine grâce, dans des situations terribles. Tous prennent des décisions que personne ne devrait avoir à prendre. Je garderai en souvenir Tchaïkovsky, ports de bras et arabesques, mais aussi les ailes d’hôpitaux, les amputations et visites au cimetière.
Un roman fort qui humanise ces gens qui vivent dans la peur et l’angoisse, une vraie réflexion sur la place de l’art dans un monde en guerre, une très très bonne lecture.