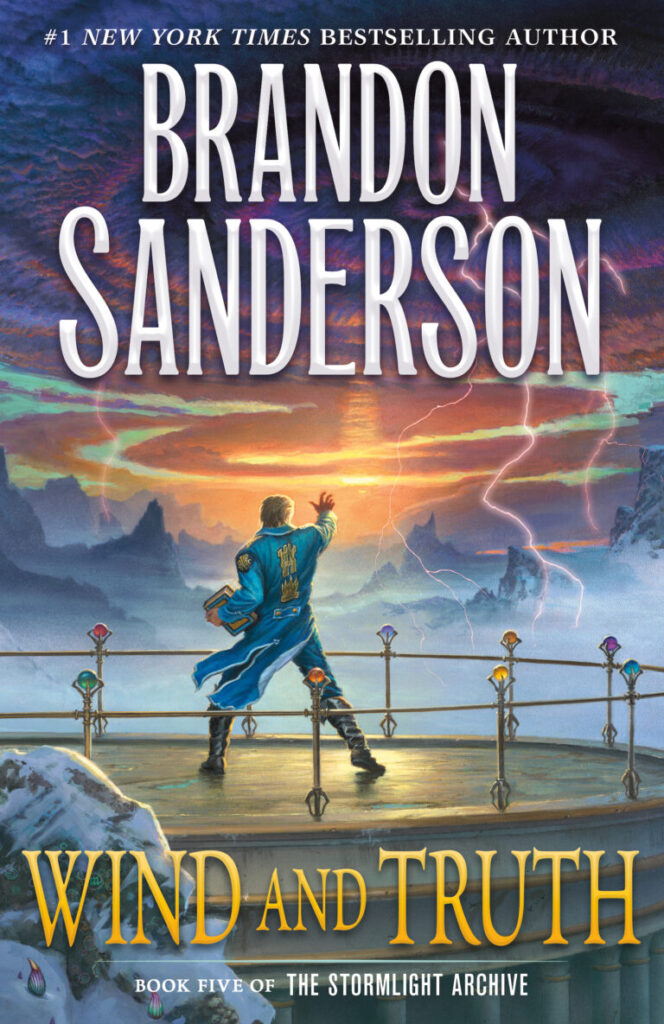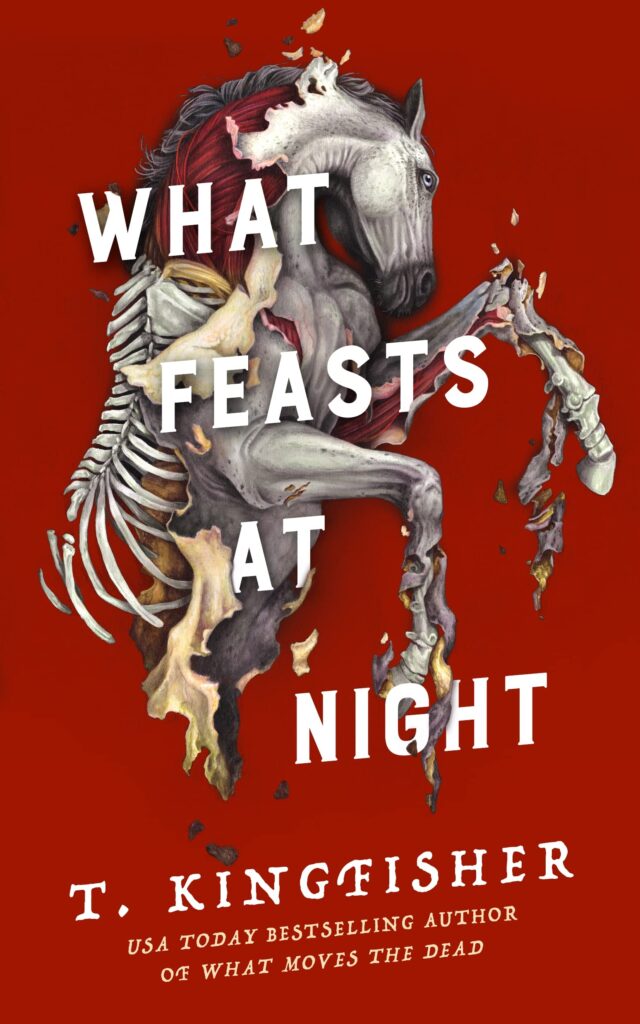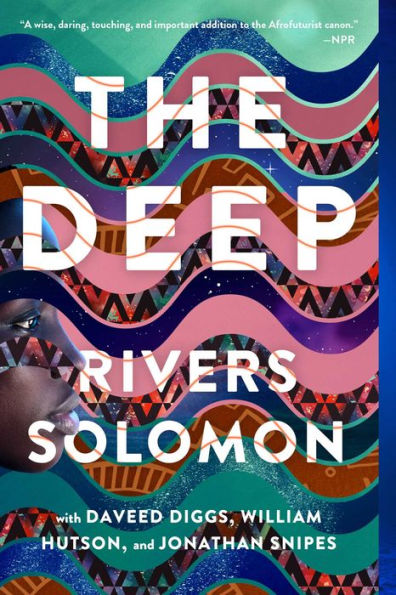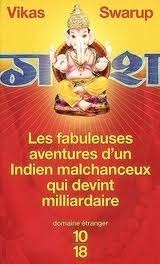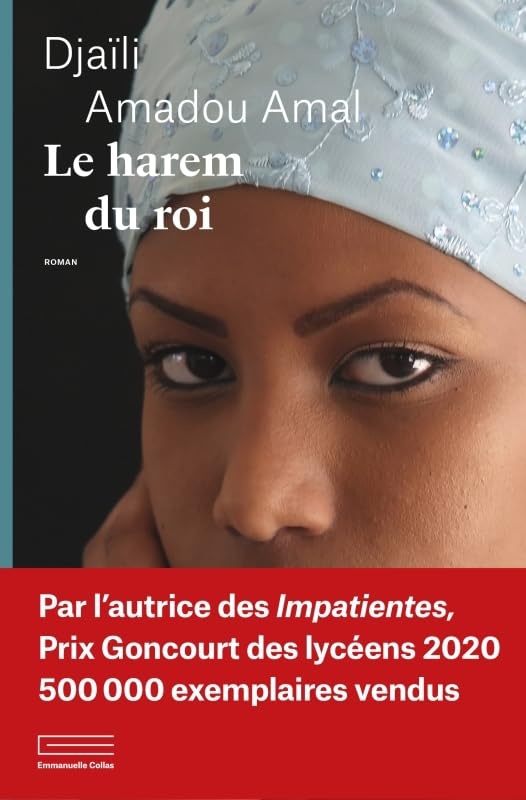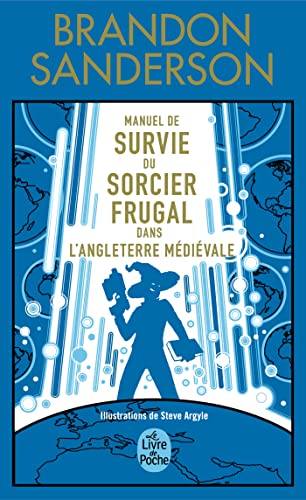Je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé Le prieuré de l’oranger, mais je n’avais pas crié au génie non plus. Pour moi, c’était une longue histoire mais une histoire au rythme rapide, qui constituait une très bonne entrée en matière dans la fantasy adulte. Et savez-vous quoi? J’ai encore mieux aimé cette préquelle, que j’ai trouvée plus mature autant dans les thèmes que dans l’écriture.
De quoi ça parle
Nous sommes dans le même univers que pour Le Prieuré de l’Oranger, mais 500 ans avant, dans la période qui s’appelle The Great Sorrow (en anglais…je l’ai lu en anglais). Nous suivons donc l’histoire de personnages dans quatre différents endroits de ce monde de fantasy, alors que du plus profond de la terre, une force se réveille, faisant apparaître de mystérieuses créatures dévastatrices.
Au Prieuré, nous rencontrons Tunuva, guerrière dont la conjointe est pressentie pour prendre la tête de l’endroit. Glorian, héritière d’Inys, doit pour sa part produire un héritier pour préserver la lignée du Saint tandis qu’en Seiiki, Dumai découvre tardivement son passé… et son avenir. Entre guerres de pouvoir et invasion de wyrms, les années s’annoncent rudes.
Mon avis
Si vous avez lu le Prieuré, vous connaissez sans doute quelques éléments de cette histoire. Je ne les révélerai pas ici mais l’autrice a réussi à tisser des liens et à enrichir son univers. Nous voyons la genèse de certaines traditions tout en restant bien ancrés dans la mythologie et dans les différentes versions de l’histoire des divinités de cet univers. Il y a des dragons, des complots de cour, un vrai ennemi à combattre… et une résolution somme toute originale. Est-ce que ça va plaire à tous? Je ne sais pas. Mais moi, j’ai vraiment aimé. L’action est somme toute plus lente que dans le Prieuré, on explore davantage les personnages et il y a plus de descriptions, ce que j’ai beaucoup apprécié!
Il y a un côté « St-George et le dragon » dans cette mythologie. Du moins, certains noms rappellent certaines versions ce cette légende. Que se serait-il passé si la princesse s’était défendue? Comment l’histoire aurait-elle été racontée? On y explore les thèmes du conflit de générations et nous avons aussi des personnages plus âgés qui ont également un développement très intéressant. Ça parle de maternité, c’est féministe, c’est queer… sérieusement, j’ai adoré.
Presque tous les personnages sont attachants, tous les arcs sont reliés d’une façon ou d’une autre et, encore une fois, l’autrice explore l’évolution des histoires et des légendes selon les parties du monde et les croyances. J’ai souffert pour les personnages, je leur ai souhaité le meilleur, leur naïveté m’a parfois exaspérée, parfois fait rire. J’ai été désespérée avec eux aussi car il est surtout question de survie dans ce roman. Il y a des côtés très héroïques, d’autres beaucoup moins, on y explore la parentalité, le deuil… bref, c’est super bien fait. Ok, il faut un moment pour bien comprendre qui est qui parce qu’il y a BEAUCOUP de personnages, mais vraiment, je suis ravie d’avoir fini par sortir cette grosse brique de 1150 pages de ma pile! Je relirai avec plaisir un autre ouvrage dans cet univers.