 Ce billet, j’y ai réfléchi longtemps avant de l’écrire. Probablement trop longtemps parce que je sens que ce qui suit va être tout sauf clair. Mais en réfléchissant bien, ce n’est probablement pas si mal. Parce que ça représente quand même bien ma lecture…
Ce billet, j’y ai réfléchi longtemps avant de l’écrire. Probablement trop longtemps parce que je sens que ce qui suit va être tout sauf clair. Mais en réfléchissant bien, ce n’est probablement pas si mal. Parce que ça représente quand même bien ma lecture…
C’est bel et bien un roman québécois qui nous entraîne dans le Paris du 17e. Dans les foires, pour être plus précise. Au milieu d’habiles faussaires, de marionettistes, d’animaux savants et de monstruosités humaines en tout genre. Nous rencontrons Marie enfant. Marie, élevée dans une famille de tisserands, est montreuse de marionnettes. Elle vit dans ce petit monde un peu – ok… beaucoup – crade et sans pitié, courant un peu partout avec Petit Pierre, son ami amoureux d’elle. Car Marie fascine. Et ayant grandi, elle fascinera l’Italien, fils de sorcière et directeur d’une compagnie d’acteurs.
Disons-le d’emblée, l’atmosphère créée par l’auteur est fascinante. C’est grouillant, souvent cruel, encore plus souvent dégueulasse. Mais c’est tangible. Et les personnages sont étonnament vivants. Si le monde est parfois dur, on retrouve aussi des bribes d’humanité dans tout ça, certes parfois bien cachées mais présentes quand même. D’entrée de jeu, on sait que ça va mal se terminer pour Marie. On la voit se passionner, on la voit espérer et on la voit aussi tomber, pour avoir voulu aller au bout du bout. Trop loin peut-être.
Entendons-nous, c’est étrange comme roman. On nous balade d’une époque à l’autre, d’un personnage à l’autre. J’ai parfois eu l’impression de fouiller dans le passé de ces gens et d’en ressortir avec quelques bribes à chaque plongée, et ce pas toujours dans le bon ordre. Et ça passe très bien. Nous sommes parfois un peu confondus mais rapidement recadrés. Et cette construction ajoute à l’aspect un peu onirique, un peu irréel de cette histoire. Car nous plongeons dans l’alchimie, la sorcellerie, les cultes étranges, presque voodoo.
Si j’ai trouvé certains passages ma foi très durs et très heu… olfactifs (à ne pas lire au petit déjeuner, croyez-moi… mais j’ai de fortes tendances malécoeureuses du coup, il ne faut pas se fier uniquement sur moi), si je me suis parfois demandé si certains détails gore étaient vraiment nécessaires, si la finale m’a un peu laissée sur ma faim et a selon moi enlevé un peu de force à l’histoire, j’ai tourné les pages et j’ai été transportée. C’est fluide et j’ai passé un bon moment de lecture.
Et ne vous fiez pas à la douceur de la couverture. Ce n’est pas du tout dans ce registre. Un roman que je ne conseillerais pas à tout le monde, pour son étrangeté et pour le côté un peu surréel mais qui m’a bien plu. Et une auteure que je relirai avec plaisir!


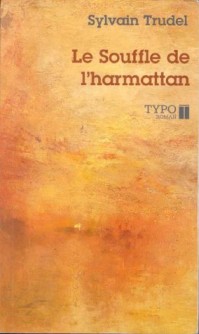 Encore un autre roman dont, je le sens, je vais avoir du mal à parler. J’en avais beaucoup entendu parler déjà mais je ne sais pas si, malgré les chaudes recommandation de plusieurs lecteurs enthousiastes, j’aurais fini par le lire sans cette lecture commune. Je vais donc essayer d’expliquer un peu mon ressenti face à ce roman profondément dérangeant et bouleversant.
Encore un autre roman dont, je le sens, je vais avoir du mal à parler. J’en avais beaucoup entendu parler déjà mais je ne sais pas si, malgré les chaudes recommandation de plusieurs lecteurs enthousiastes, j’aurais fini par le lire sans cette lecture commune. Je vais donc essayer d’expliquer un peu mon ressenti face à ce roman profondément dérangeant et bouleversant. 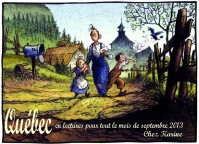
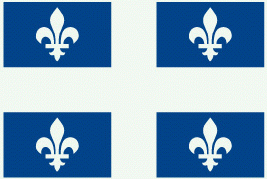
 Jacques Poulin restera toujours Jacques Poulin. Toutefois, ce roman constitue ma deuxième semi-déception avec cet auteur (la première étant « L’homme de la Saskatchewan » que j’avais aimé sans être marquée). En effet, celui-ci ne restera probablement pas dans mes annales personnelles, même si j’ai quand même passé un agréable moment de lecture.
Jacques Poulin restera toujours Jacques Poulin. Toutefois, ce roman constitue ma deuxième semi-déception avec cet auteur (la première étant « L’homme de la Saskatchewan » que j’avais aimé sans être marquée). En effet, celui-ci ne restera probablement pas dans mes annales personnelles, même si j’ai quand même passé un agréable moment de lecture. Aujourd’hui, c’est théâtre!
Aujourd’hui, c’est théâtre!














 Ooooh, comme elle a l’air pas commode, cette fillette! Elle irait parfaitement avec celles que nour raconte Michel Tremblay dans ce roman qui le deuxième des chroniques du Plateau Mont-Royal.
Ooooh, comme elle a l’air pas commode, cette fillette! Elle irait parfaitement avec celles que nour raconte Michel Tremblay dans ce roman qui le deuxième des chroniques du Plateau Mont-Royal. 


















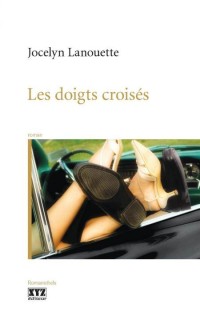 Ce livre et moi, on a eu une drôle d’histoire.
Ce livre et moi, on a eu une drôle d’histoire. 